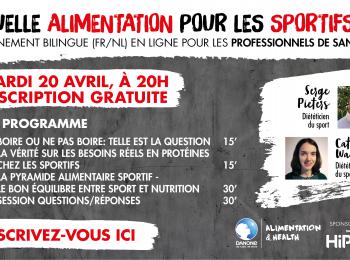Les produits laitiers dans un régime alimentaire sain et durable
En Belgique, les apports moyens habituels en calcium sont en moyenne de 760 mg par jour soit inférieur au 950 mg recommandé par jour (1). Les produits laitiers occupent une place essentielle dans notre alimentation quotidienne. Grâce à leur densité nutritionnelle élevée, ce sont des aliments inconto...